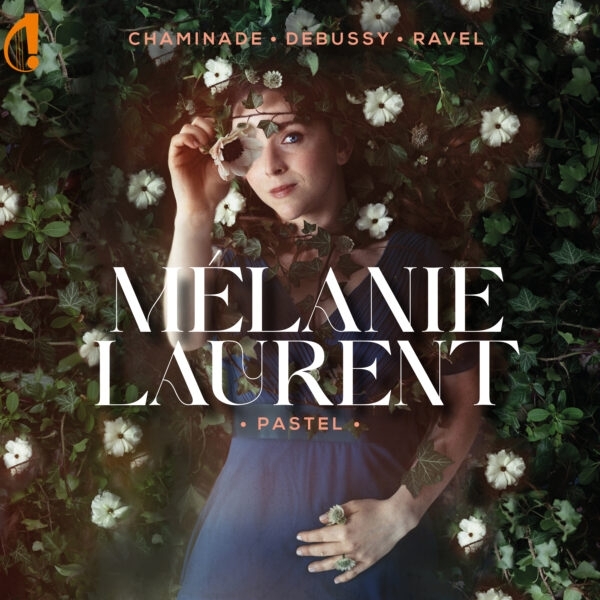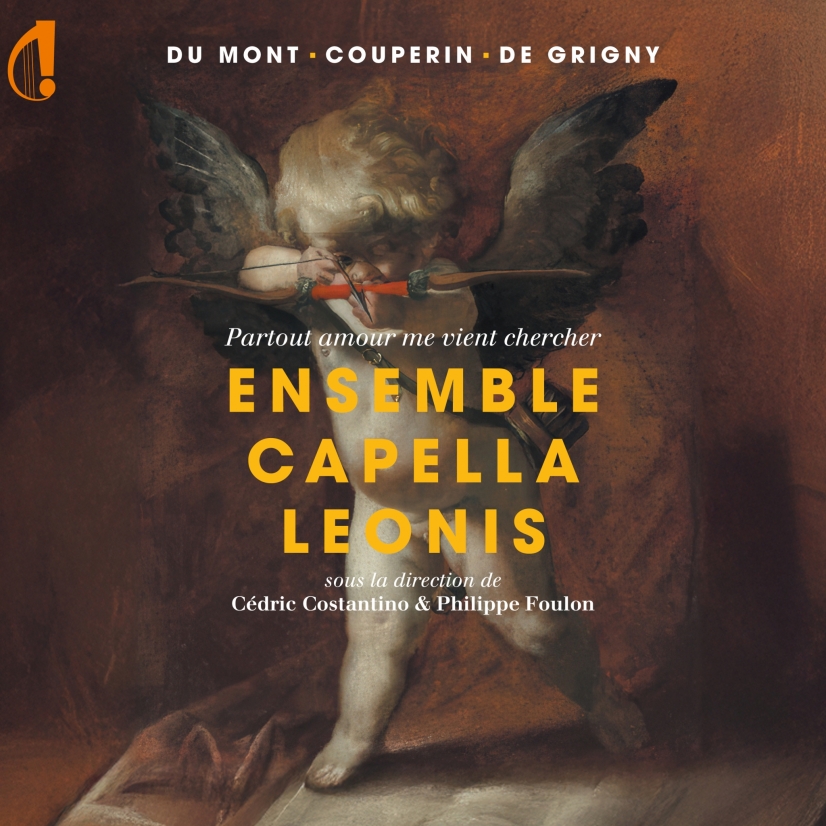Livre ••• Roman ••• Arsène K., Échange de patins
"Faire peau à peau avec ce bijou de musique"

Bla Bla Blog avait terminé l’année 2025 en beauté la découverte de VENEREM et leur album Strike. Une sacrée claque. Nous avons voulu en savoir plus sur ce groupe sacrément audacieux pour leur approche singulière du classique. Marlo Thinnes et Laureen Stoulig-Thinnes, deux des quatre membres de VENEREM, ont bien voulu répondre à nos questions.
Bla Bla Blog – Bonjour. Pouvez-vous nous présenter Venerem ? Et d’abord, d’où venez-vous ?
Laureen Stoulig-Thinnes – Mes racines sont multiples : mon père est français mais ma mère est mauricienne, née d'un papa indien et d'une maman africaine. Le fait qu’on y parle le créole et que ce coin de paradis soit naturellement marqué par de nombreuses influences culturelles et religieuses est peut-être aussi la raison pour laquelle je ne suis pas une puriste. Le mélange des différentes influences, y compris musicales, m’a toujours fascinée. Je suis chanteuse baroque et classique, mais j’ai toujours été très ouverte d’esprit. VENEREM m’offre une chance de diversité, et c’est quelque chose que j’apprécie énormément. Peut-être quelques mots sur VENEREM, même si l’écoute de notre musique transmet sans doute plus que n’importe quel discours : VENEREM crée une musique d’un style inhabituel et sans précédent. Comme l’a récemment souligné un critique suisse, les arrangements de VENEREM ressemblent davantage à des œuvres d’art transformées, basées sur la musique ancienne allant de la Renaissance au baroque tardif. Ce style fait l’objet d’une modernisation audacieuse, qui projette l’art ancien vers l’avenir. Sur le plan des idées comme de l’artisanat musical, nos arrangements s’inspirent du classicisme et du romantisme tardif. On sait que la musique ancienne laissait souvent une grande place à l’improvisation, et VENEREM exploite pleinement cette liberté pour créer quelque chose d’individuel, de totalement nouveau. L’auditeur a l’impression d’entendre des œuvres originales : les fondements musicaux sont transformés de manière convaincante, avec un sens aigu de l’entrelacement des motifs, du contrepoint et des harmonies contrastées. Chez VENEREM, soprano, piano, basse électrique et percussions fusionnent en une combinaison envoûtante qui donne envie d’en entendre toujours plus.
BBB – Votre album Strike est un projet singulier, alliant musique classique et jazz. Qui a eu l’idée de cette lancer dans une telle aventure musicale ?
LST – VENEREM n’est plus un projet : nous sommes arrivés à un point d’aboutissement et nous nous sentons désormais comme un ensemble réellement stable et affirmé. L'idée est née de l'écoute d'un disque de L'Arpeggiata, formidable formation dirigée par Christina Pluhar. J'ai alors compris qu'on "avait le droit" de toucher ainsi à la musique ancienne. Mon mari [Marlo Thinnes] connaît mon amour pour la liberté et, avec passion et génie, il m'a suivie.
"J'ai compris qu'on "avait le droit" de toucher ainsi à la musique ancienne"
BBB – Mêler jazz et classique n’est pas nouveau. On pense à Jacques Loussier et à son Trio Play Bach. Dans quelle mesure son travail et son œuvre vous a influencé ?
LST – Mon mari écrit les arrangements. C’est lui qui a donné un visage à VENEREM. Je ne sais pas vraiment comment il fait. En tous cas, je dois dire que je me sens comme une reine à qui l’on déroule le tapis rouge — musicalement parlant ! À chaque arrangement, il parvient à me surprendre davantage. J’adore cela et je perçois aussi toutes les transformations subtiles, puisque je connais les œuvres originales. Je pense cependant que, de manière générale, son empreinte personnelle, sa façon de penser issue de la musique classique — peut-être du baroque tardif jusqu’au romantisme tardif — s’y reflète fortement.
BBB – Le second morceau de Purcell est le célèbre Cold Song. Comment qualifiez-vous votre adaptation ? Classique ? Baroque ? Jazz ? Ou bien rock ? Avec beaucoup de pièges pour la voix de la chanteuse.
LST – Cold Song est né en une seule répétition. Il n’y avait pas grand-chose à faire. Marlo sait quand il vaut mieux réduire, n’utiliser que quelques effets. Je crois que cette musique est déjà si particulière et si puissante dans sa version originale qu’un arrangement trop ample ne ferait que la perturber. Et puis, je suis particulièrement fan de ce que Michel [Michel Meis], notre fou de batteur parvient à produire dans cette pièce. Tant de silence et de mystère naissent de son jeu. Il y a une sorte de transe qui peut s'installer en moi. il s'agit alors de se laisser habiter et transporter. La voix elle-même en est surprise je pense. Une expérience merveilleuse et défi considérable…
BBB – Reynaldo Hahn fait partie des compositeurs que l’on redécouvre en ce moment. On n’est donc qu’à moitié étonné de le retrouver ici. Vous avez choisi la pièce À Chloris. Pourquoi cette œuvre ?
LST – Comme déjà mentionné, les exceptions confirment la règle ! Et puis, j'avais envie de faire peau à peau avec ce bijou de musique si délicat, lumineux qu'il faut chérir dans chaque note, dans chaque respiration, et mon cœur s'enivre de ces mots d'amour, d'ambroisie. Quelle chance de se laisser habiter et d'articuler tant de beautés !
BBB – Pouvez-vous nous parler de vos futurs projets, que ce soit à la scène ou en studio ?
LST – Plusieurs concerts passionnants sont à venir... et une magnifique invitation du Festival baroque de La Valette, à Malte, pour janvier 2027. De nouveaux arrangements sont également en cours d’élaboration, et un autre album studio est déjà en gestation. Sans oublier mon souhait de co-créer avec une artiste indienne… Let's see !
BBB – Bla Bla Blog aime être touche à tout. Pouvez-vous nous parler de vos derniers coups de cœur au cinéma, à la télévision, dans les galeries et bien sûr en musique ?
LST – A vrai dire, l'écoute du silence me passionne bien plus que l'écoute de la musique. J'ai récemment adoré pouvoir regarder et ressentir les œuvres de Zoran Music, exposées à Paris. Les lectures de Rumi me font toujours autant voyager. Je ne regarde jamais la télé et ne vais que très rarement au cinéma, mais si il faut nommer un média, alors j'adore voyager sur Youtube, et tout spécialement partir à la rencontre d'éveilleurs de conscience, tels que le physicien Philippe Guillemant, ou la chamane Sandrine ShannAmer que je vais bientôt rencontrer et avec qui j'ai déjà des échanges très nourrissants. Les chemins de vie tels que celui de Lamya Essemlali qui protège les mers et les baleines, nos "gardiennes des mémoires du Monde", suscitent mon plus grand respect, ma plus grande écoute et admiration.
BBB – Merci.
Venerem, Strike, Orlando, 2025
https://www.venerem-art-music.com
https://orlando-records.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057786787723
https://laureenstoulig.fr
https://www.instagram.com/venerem_early_art_music
Voir aussi : "Irrévérence et vénération"
"Made in Switzerland"
Tenez-vous informés de nos derniers blablas
en vous abonnant gratuitement à notre newsletter.
Likez, partagez et instagramez les blablas de Bla Bla Blog !