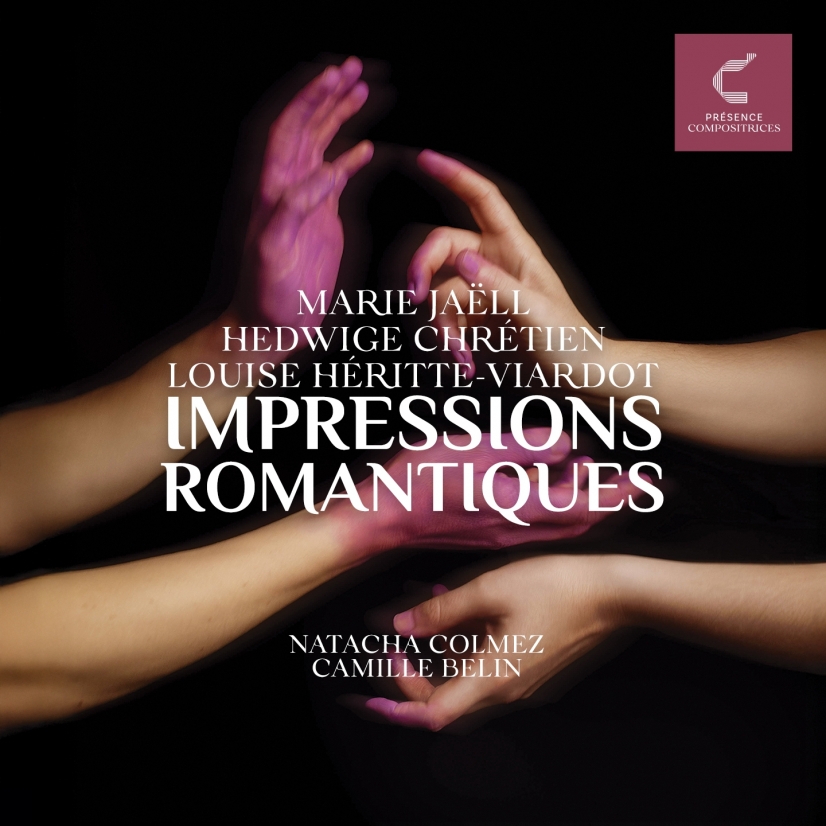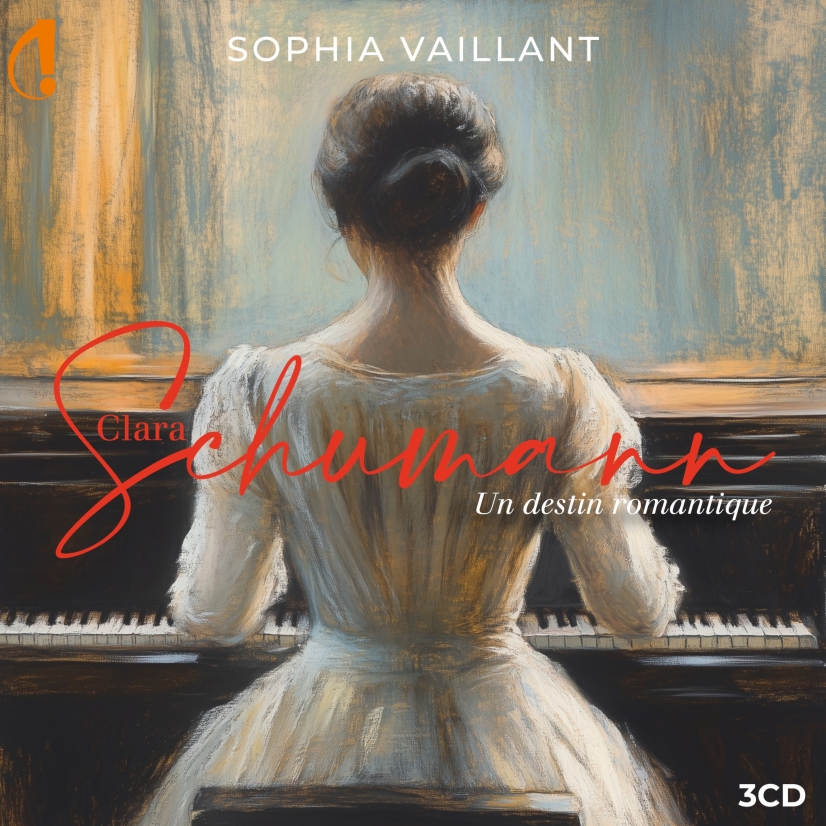Made in Switzerland

Ces trois là nous viennent de Suisse – de Romandie pour être plus exact. Ils nous proposent avec l'album Secret Songs (chez Indésens) un programme de musique allemande. La soprano Léonie Renaud, le clarinettiste Damien Bachmann et le pianiste Christian Chamorel s’attaquent à trois figures du romantisme germanique, à savoir Louis Spohr, Carl Maria von Weber et l’incontournable Franz Schubert.
Arrêtons-nous d’abord sur les deux premiers. Louis – né Ludwig – Spohr (1784-1859), assez rare sur disques et en concerts, a pourtant été le plus grand compositeur de son époque, après les morts de Weber et surtout de Beethoven. Chef d’orchestre archidoué et pédagogue reconnu, il a su faire sa place dans le beau monde allemand et autrichien. On le découvre ici comme compositeur de Six Lieder allemands.
Léonie Renaud s’en empare avec bonheur, alternant passion ravageuse (Sei still mein Herz : "Sois calme mon cœur, et n'y pense plus, / C'est maintenant la vérité, le reste est illusion."), candeur (le court et bucolique Zwiegesang), mélancolie (Sehnsucht) ou nostalgie (Das heimliche Lied). L’auditrice ou l’auditeur fondera à l’écoute de la berceuse (Wiegenlied), comme susurrée par la soprano suisse. La clarinette de Damien Bachmann semble se pencher tout autant au-dessus de l’enfant sur le point de s’abandonner. Il faut saluer le trio d’artistes en osmose dans un programme de chambre d’une très grande finesse. Christian Chamorel, que nous avions croisé avec Rachel Kolly dans un remarquable album sur Brahms, accompagne avec tact et efficacité ses deux acolytes, laissant la place à une Léonie Renaud enflammée (le vibrant Wach auf!) et un Damien Bachmann éclatant, donnant à son instrument souffles, rythmes et couleurs.
Il faut saluer le trio d’artistes en osmose dans un programme de chambre d’une très grande finesse
Jusque là discret, Christian Chamorel prend une place plus importante dans le Grand Duo concertant pour clarinette et piano op. 48 de Carl Maria von Weber (1786-1826). Une autre figure reconnue du romantisme allemand, mais lui aussi boudé après sa mort prématurée à l’âge de 39 ans – il était d’une santé fragile. Weber a laissé une œuvre abondante souvent peu jouée, si l’on excepte son opéra Der Freischütz. On le retrouve ici dans ce Grand duo en mi bémol majeur. Bachmann et Chamorel s’y disputent la vedette avec virtuosité (Allegro con fuoco). Le romantisme pointe le bout de son nez dans l’Andante con moto à la beauté funèbre, avant que la vie ne danse avec la nuit (le scintillant Rondo: Allegro).
Franz Schubert (1797-1827) apparaît comme la grande star de ce programme romantique. Renaud, Bachmann et Chamorel ont choisi 5 lieder représentatifs du génie allemand. Il y a ce court An den Frühling, pudique chant de bienvenue et de regret adressé à un jeune homme. Le Sprache der Liebe, quant à lui, plus long, est la déclaration à une bien-aimée, en musique bien sûr. Avec le lied Rastlose Liebe, op. 5 n°1, nous retrouvons l’ADN du romantisme dans lequel nature et sentiments sont étroitement liés. Léonie l’a parfaitement compris, qui insuffle sa fougue et sa douloureuse passion.
L’amour, toujours l’amour, avons-nous envie de dire en écoutant le Sei mir gegrüßt!, déchirante adaptation d’un poème des Roses d’Orient de Friedrich Rückert en forme de missive ("Je suis avec toi, / Tu es avec moi, / Je te serre dans mes bras, / Salutations ! / Je t'embrasse !"). La poétesse Caroline Louise von Klencke est l’autrice du texte d’Heimliches Lieben op. 106. n°1. Schubert semble se faire à la fois plus léger et aussi plus sensuel dans le poème originellement nommé À Myrtille : "Ma vie, en cet instant, ne tient qu'à ta douce bouche rosée, et manque de m'abandonner dans ton étreinte intime". Quelle belle déclaration ! La soprano l’interprète avec sensualité.
L’album s’achève sur Le pâtre sur le rocher (Der Hirt auf dem Felsen, op. 129 D. 965), sans doute l’une des plus belles pièces du programme. Schubert compose ce lied incroyable sur son lit de mort en 1828. Impossible de ne pas voir dans ce chef d’œuvre un long et poig, autant qu'un chant d’amour pour la vie. La clarinette de Damien Bachmann est une merveille et Léonie Renaud y amène puissance vocale et accents pathétiques : "Bientôt ce sera le printemps / Le printemps, mon espoir / Il me faut maintenant / M'apprêter à partir". Une merveille. On n’est pas prêts d’oublier les dernières mesures de ce Pâtre sur le rocher.
Renaud / Bachmann / Chamorel, Secret Songs, Schubert / Spohr / Weber,
Indésens Calliope Records, 2025
https://indesenscalliope.com
https://www.leonierenaud.ch
https://damienbachmann.com
https://christianchamorel.ch
Voir aussi : "Brahms doublement suisse (et même triplement)"
"Les nouveaux romantiques"
Tenez-vous informés de nos derniers blablas
en vous abonnant gratuitement à notre newsletter.
Likez, partagez et instagramez les blablas de Bla Bla Blog !