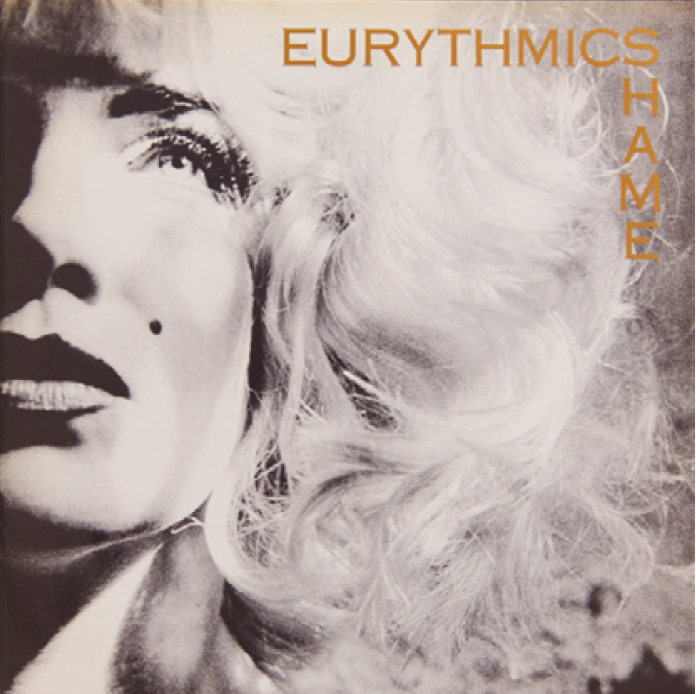L’exposition Les Géorgiques présente des œuvres picturales et des dessins de Adrien Belgrand, Yann Lacroix, Abel Pradalié, Arnaud Rochard. Le dialogue entre ces quatre artistes français est une projection contemporaine du mythe de l’âge d’or. Il renvoie à la littérature antique qui chez Virgile, Tibulle avant lui et Fénelon s’est donné la mission de décrire et de situer un temps du plaisir et de la quiétude. Cet instant perdu, objet de fantasmes et de délires et aussi le moteur d’une pensée politique, celle de l’utopie.
26 mai 2018, Naples. Quelques lignes d’un brouillon me viennent, en promenade au parc virgilien. Des familles, quelques couples enlacés, des amis silencieux. Tous goûtent le calme d’avoir échappé à la ville, au tumulte, à la fantaisie du hasard. Un long poème effeuillé au vent, dans la moiteur d’un été tropical. Une promenade sans peine dans les méandres d’une nature sauvegardée. Un instant de contemplation dans la quiétude d’un soir qui tombe. Une rencontre magique à l’orée d’une forêt. La nostalgie d’un passé meilleur s’élance à la recherche d’un présent mystérieux, capable de retenir en lui ce qui satisfait l’expérience du plaisir. L’âge d’or est un mythe éternel et une projection empirique, à la recherche d’un instant suspendu, assez fort, assez grand, assez tendre pour être contemplé comme un éternel présent…
Adrien Belgrand
Dans un ciel crépusculaire, dilaté par la chaleur mourante, une nature dense, exposée à quelques rayons de lumière déjà s’endort dans un lit d’ombres. Le léger mouvement des arbres suggéré par des touches enlevées s’accorde avec les tonalités bleues, grises et l’ocre d’une terre balayé par la poussière à l’horizon. Porte méridionale de Châtillon, baignée par la lumière, Saint-Roman s’expose à un moment de grâce. L’œuvre éponyme converse avec la quiétude estivale des vacanciers et des habitués qui se retrouve à Malmousque pour un bain de mer. Les corps oints, alanguis ou observateurs sont peints de dos, le regard adressé à la mer. Une figure debout, proche du remous des vagues capte l’attention tandis que les autres estivants semblent hésiter à aller se baigner. Le sable lui-même houleux et chiffonné, accidenté par le passage vif des pas symbolise une introspection et l’attente du retour au calme. L’horizon clair est à peine entamé par un vague passage de sable sur les côtes opposées. Les paysages d’Adrien Legrand matérialisent la tendre pesanteur du paysage, sa tension exquise dans un moment de flottement où la lumière construit la dramaturgie d’un frisson. Les sens altérés par les remous et les souffles d’air s’aiguisent.
Yann Lacroix
Les œuvres de Yann Lacroix énoncent l’étrange sensation d’être au seuil de la compréhension d’un instant, ce moment délicat où la conscience, chahutée par les signes, rassemble ses forces pour décrypter le message d’une situation. Pourquoi se perdre ainsi dans la traduction de nos émotions, de nos souvenirs, de notre environnement ? Les peintures de Yann Lacroix portent une réflexion sur le post-colonialisme par l’image fantasmée et les hétérotopies contemporaines. L’orientalisme, accidenté par les souvenirs se concentre dans des détails d’un paysage spéculatif, comme des instantanés d’un vue reconstruite, fluctuante au fur et à mesure des découvertes et des voyages, des temps dédiés à la contemplation. La précision et l’authenticité sont ainsi écartées. Est retenu l’émotion vivace du souvenir et la joie de la tentative de retrouver ce qui a été vu, ce qui a été ressenti. Les lacunes sont volontaires et marquées par les flous, les décadrages, provoquant ainsi une réalité marginale de l’action, contenu dans le détail, dans la perspective ou l’accumulation des plans. L’enchevêtrement des techniques résorbe le paysage, le dissous dans la matière. Plus ces paysages nous apparaissent comme des vues familières, plus ils semblent se dérober à notre entendement.
Abel Pradalié
Abel Pradalié travaille à la construction d’une représentation ouverte d’un quotidien habité par l’Histoire et les fétiches de la ruine, les icônes de la culture populaire et l’humeur des souvenirs personnels. Ses paysages sont des fragments d’un Éden subjectif. La peinture sur le motif et le travail d’atelier explorent les fondements de la construction du paysage, résolu par les caprices du thème. Le paysage s’offre en promenade, au détour d’un chemin familier, d’un village reconnu, d’une maison retrouvée. La maison d’une éternelle vacance, habitée par les réminiscences. L’enfance et les excursions printanières d’une Bourgogne amicale, la recherche d’un parterre ombragé, la fuite à travers champs, la rencontre inopinée avec une baigneuse, jusqu’à l’improbable Tarzan, joueur et ingénu, éperdu de ses songes. Abel Pradalié transforme l’âge d’or dans le quotidien même, espace infini de détails éparses, rassemblés par les habitudes et la répétition. La réalité quotidienne ne s’absout pas de l’imagination, du caprice, de la fantaisie. Celle-là même qui fait emprunter plusieurs fois la même route, celle des pauses postprandiales ou des fouilles archéologiques par lesquelles le passé revient par bribes, par fragments clairsemés.
Arnaud Rochard
Le paysage semble s’étouffer lui-même dans la proximité des plantes entre elles, la variété des tailles et la complexité des formes de la végétation, abondante et merveilleuse. Les couleurs outrées, rehaussées encore par le contraste marqué des silhouettes et des ombres composent des paysages en motif, rappelant en télescopage volontaire les recherches de William Morris et les teintes de la peinture fauve. Les arts décoratifs s’imposent comme un réservoir de références de formes, tandis que la composition évolue, à la mesure des influences, qu’elles soient techniques (gravure, tapisserie) ou picturale (les Nabis, Van Gogh). La séduisante irréalité des paysages surprend et suggère l’existence d’un Éden, d’un état primordial d’une Nature préservée, originelle. Une Nature habitée par un élan vital indomptable, une force brulante. Le Japonisme apparaît par citations, et l’expérience exotique rappelle les paysages bigarrés de Gauguin. Chaque paysage est construit par addition d’éléments d’époques et de supports distincts, créant une synthèse indéchiffrable. Ce mystère du paysage multiple préserve de toute possible réponse définitive. Jungles et forêts d’un monde de spéculation, les œuvres d’Arnaud Rochard retranscrive une rêverie.
…L’âge d’or est le premier programme politique d’une écologie sensorielle. Comprendre notre environnement suppose d’en faire l’expérience intime, d’entretenir avec lui une proximité originelle, celle d’une nature vierge, non bafouée.
Le mythe de l’âge d’or est à la fois un leitmotiv artistique et littéraire. Il construit un rapport à l’histoire et aux événements et propose d’inscrire l’utopie humaine dans un temps éloigné, l’aventure du souvenir. Cette dialectique d’une esthétique naturelle du bonheur est en même temps une critique de la dystopie urbaine et une réinterprétation panthéiste de la communauté humaine. A l’écart du brouhaha et des affres de la Cité, l’âge d’or est aussi par métaphore et symbolisme l’ailleurs, le voyage, la villégiature, moment de retrait et de simplicité. Les corps dilatés et les esprits au repos s’émeuvent d’une inexplicable symbiose. Perdus, livrés à l’éternité féconde, ils s’entendent et se consolent.
Théo-Mario Coppola
Exposition "Les Géorgiques", Galerie Detais/Sabine Bayasli
Jusqu'au 21 juillet du mardi au samedi de 14h à 19h