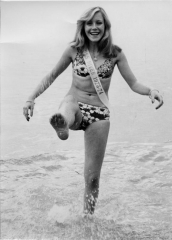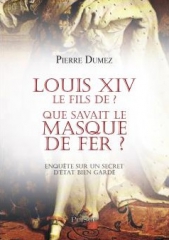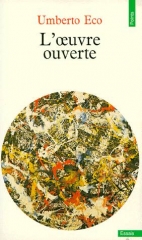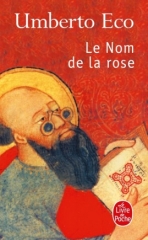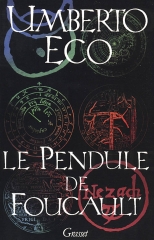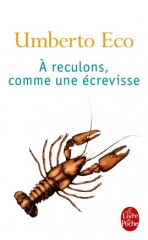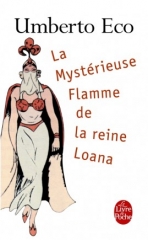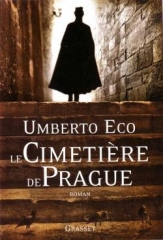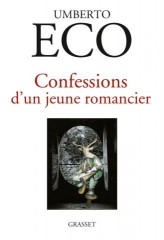Musique & télévision ••• Classique ••• Yuja Wang interprète "Rhapsody in Blue"
25 bougies et 100 numéros pour "Qantara", le magazine des cultures arabe et méditerranéenne
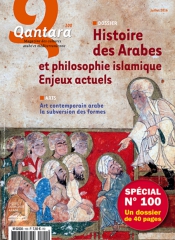 En 25 ans et 100 numéros, Qantara, le magazine de l’Institut du monde arabe, s’est fait le spécialiste des cultures arabe et méditerranéenne. Le numéro spécial proposé cet été brosse un tableau singulier d’une civilisation si mal connue en Occident. L’occasion était trop belle pour l’Institut du monde arabe de faire de ce numéro 100 non un florilège d’articles ou de textes mais une passionnante investigation sur l’héritage culturel arabe et la philosophie islamique.
En 25 ans et 100 numéros, Qantara, le magazine de l’Institut du monde arabe, s’est fait le spécialiste des cultures arabe et méditerranéenne. Le numéro spécial proposé cet été brosse un tableau singulier d’une civilisation si mal connue en Occident. L’occasion était trop belle pour l’Institut du monde arabe de faire de ce numéro 100 non un florilège d’articles ou de textes mais une passionnante investigation sur l’héritage culturel arabe et la philosophie islamique.
Outre plusieurs passionnants articles sur l’art contemporain arabe, un portrait de la scientifique et aventurière Gertrude Bell, un récit de l’escadrille La Fayette ou un voyage à Abu Dhabi, le centième de Qantara consacre 40 pages à une historiographie arabe et musulmane d’autant plus nécessaire en cette période faite de crispations, de querelles (par exemple, l’affaire du burquini cet été), de violences sur fond d’islamisme radical (Daech), de défiances et d’incompréhensions.
La difficulté des historiens arabes est complexe, comme le dit en substance François Zabbal en introduction de ce dossier : "L’historien arabe s’est trouvé confronté à une tâche singulière : contribuer à la formation d’un récit national délimité par les nouvelles frontières, mais plongeant ses racines dans un passé antique complexe." La philosophie pose d’autres questions : "Comment définir [la philosophie dite "islamique"] en dehors de la phase de transmission du savoir grec à l’Occident" ?
L’interview d’Eric Vallet par François Zabbal nous éclaire sur la naissance d’une historiographie arabe qui tourne le dos à l’orientalisme. À partir des années 50, l’histoire médiévale musulmane se dote d’outils et de ressources sur le modèle de ceux utilisés pour l’étude du Moyen Âge occidental.
Une autre interview, celle-là de Philippe Sénac, aborde un sujet classique dans l’histoire universitaire : celui des liens entre Charlemagne et l’Islam. Prenant appui sur la thèse d’Henri Pirenne, Mahomet et Charlemagne (1937), il est question des relations entre le monde franc et l’Islam aux VIIIe et IXe siècles. Et une question cruciale est abordée : celle d’une "dette de l’Occident vis à vis de l’Orient", qui entraîne d’autres problématiques : celle de l’enseignement comme celle d’une certaine "complaisance" (un "politiquement correct") vis-à-vis de sujets graves, que ce soient les conflits ou les crises politico-religieuses.
Ce politiquement correct épinglé par Philippe Sénac n’est pas le problème de Gabriel Martinez-Gros qui parle sans fard dans un article dense, passionné et documenté d’héritage colonial, de décolonisation, de tiers-mondialisme et de culpabilité : "[Le tiers-mondisme] inflige à l’Occident le châtiment de la "repentance", mais il lui conserve le devant de la scène… Le tiers-mondialisme est aujourd’hui en Occident une sorte d’impérialisme de la culpabilité ; une culpabilité qui nous donne le droit – ou mieux nous fait obligation – d’agir partout… Nos actions ne feront que réparer le mal que nos actions précédentes ont provoqué." Gabriel Martinez-Gros aborde un autre sujet capital : celui du djihadisme d’aujourd’hui. Daech est vu sous l’angle du chaos sanglant qu’il génère mais également sous le prisme d’une volonté d’un ordre odieux (la charia) et de purification extrême jusque dans la langue : "Le communiqué de Daesh publié après les attentats de novembre à Paris ne comptait pas le moindre mot qu’un écrivain du cercle de Saladin au XIIe siècle n’aurait pu employer" nous apprend l’historien qui pointe également du doigt la préférence de Daech pour les volontaires venus d’ailleurs, au détriment des "autochtones".
Dans l'article "La quête de l’antique", Ridha Moumni aborde un sujet peu connu en France : celle de l’héritage carthaginois en Tunisie. Cette question a été le fer-de-lance identitaire après l’indépendance de ce pays. À l’époque coloniale, l’héritage romain – certes important - participait d’une dialectique coloniale. Ridha Moumni explique comment le président Bourguiba s’est empressé de détrôner Rome pour revisiter le passé de Carthage. Cet héritage punique reste plus que jamais présent depuis la chute de Ben Ali en 2011, même si la Tunisie tend à mieux intégrer le double héritage, romain et carthaginois.
La seconde partie de ce dossier spécial est consacrée à cette philosophie arabe. Ali Benmakhlouf, professeur d’Université à Paris-Est Créteil parle longuement du champ de cette science, et d’abord de l’héritage grec "qui fut un présupposé nécessaire" : "La philosophie, sous son versant logique, apparaît comme une pratique mettant à la disposition des hommes un outil : le syllogisme", dit le chercheur en référence à Averroès. De cet héritage, le monde musulman a construit une philosophie originale (Averroès ou Al-Fârâbî), avec une importance capitale donnée à la métphysique, à la théologie et aux textes juridiques.
Averroès (1126-1198) fait l’objet d’un article à part. Jean-Baptiste Brenet explique l’importance de ce savant de "l’Islam des Lumières", le meilleur exégète d’Aristote, critiqué à son époque et taxé par certains de blasphémateur. Sans doute mérite-t-il de figurer parmi les grands penseurs de l’humanité. Jean-Baptiste Brenet nous explique pourquoi.
Un entretien avec Christian Jambet permet de comprendre les notions de philosophie islamique, philosophie arabe, philosophie sunnite et philosophie chiite. La "philosophie en terre d’Islam" a bien une cohérence, insiste le chercheur, malgré les différences de langues (arabe, persan), de cultures et de religions (musulmans, chrétiens ou juifs). Pour autant, Christian Jambet n’oublie pas les schismes et les controverses qui ont émaillé l’histoire de la science philosophique islamique : l’âge d’or (Ibn Bâjja, Ibn Tufayl ou Averroès) puis le déclin de la philosophie sunnite, le mouvement chiite vigoureux d’autre part (Avicenne, Al-Fârâbî) nourri par les néoplatoniciens, sans oublier ces courants de pensées (et aussi politico-religieux) peu connus en Occidents et que le lecteur de Qantara permettra de découvrir : l'ismaélisme ou le chiisme duodécimain en premier lieu.
Le dernier article de ce dossier est pour l’essentiel consacré à une œuvre majeure : L’Aimé des Cœurs du philosophe iranien Qutb al-Din Ashkevarî. "La sagesse a-t-elle une histoire ?" s’interroge d’emblée Mathieu Terrier qui s’intéresse à la transmission des savoirs étrangers (grecs, bien entendu, mais aussi indiens et persans). Les vies et les doctrines des sages anciens – qu’ils soient ou non musulmans – sont relatés dans des doxographies : "Les ouvrages biodoxographiques ont pourvu la philosophie en problèmes, thèses et personnages conceptuels de sages. En retour, la philosophie… a fourni ses grandes orientations à l’historiographie de la sagesse." Le plus important de ces ouvrages est L’Aimé des Cœurs de Qutb al-Din Ashkevarî. Écrit au XVIIe siècle, en arabe et en persan, c’est la plus ambitieuse de ces histoires de la sagesse, puisqu’il part de l’origine de l’homme (Adam) jusqu’à l’auteur lui-même. Les sages décrits, grâce à des sources variées, couvrent un large éventail de pays et de cultures : de Socrate aux imams du chiisme, en passant par Zoroastre ou Empédocle. Mathieu Terrier insiste sur la spécificité de ce genre littéraire, méprisé en Occident mais pourtant d’une grande ambition intellectuelle et d’une portée populaire indéniable. En cela, dit le chercheur, "L’Aimé des Cœurs témoigne d’un tout autre Islam que celui qui ravage aujourd’hui le Moyen Orient et terrorise ponctuellement le monde occidental."
Qantara, n°100, Dossier Spécial n° 100, Histoire des Arabes et philosophie islamique
Enjeux actuels, été 2016, 40 pages, en vente en kiosques et en librairies,
dont celle de l’IMA
www.qantara-med.org