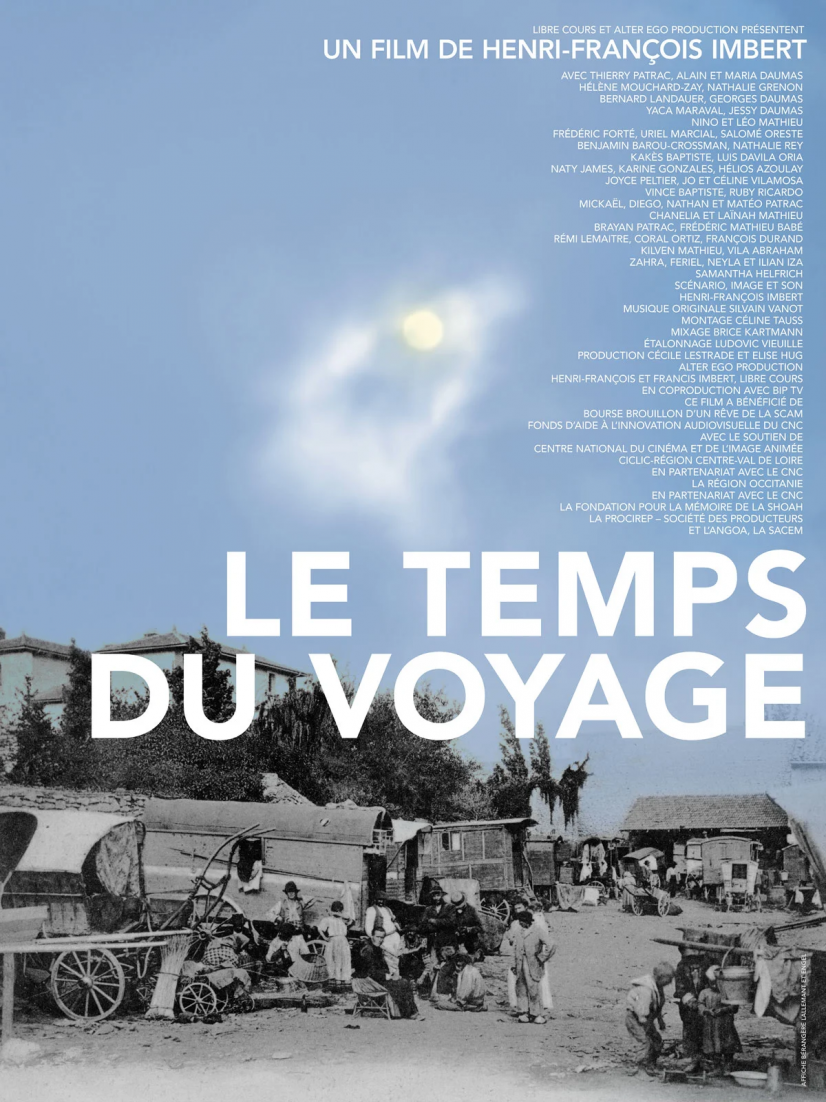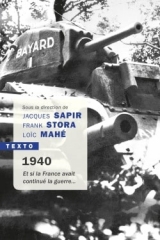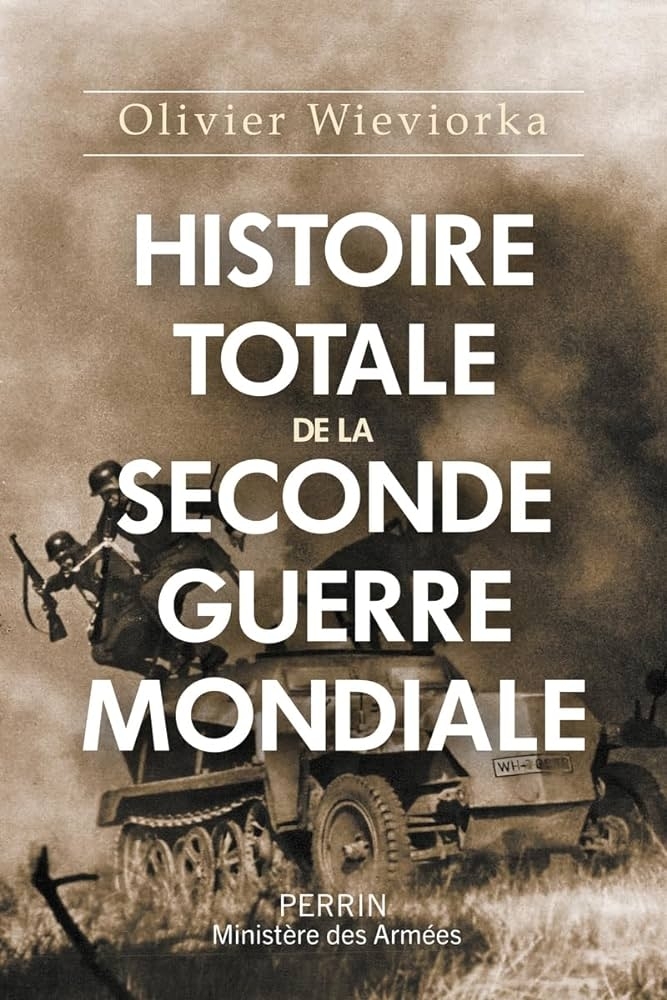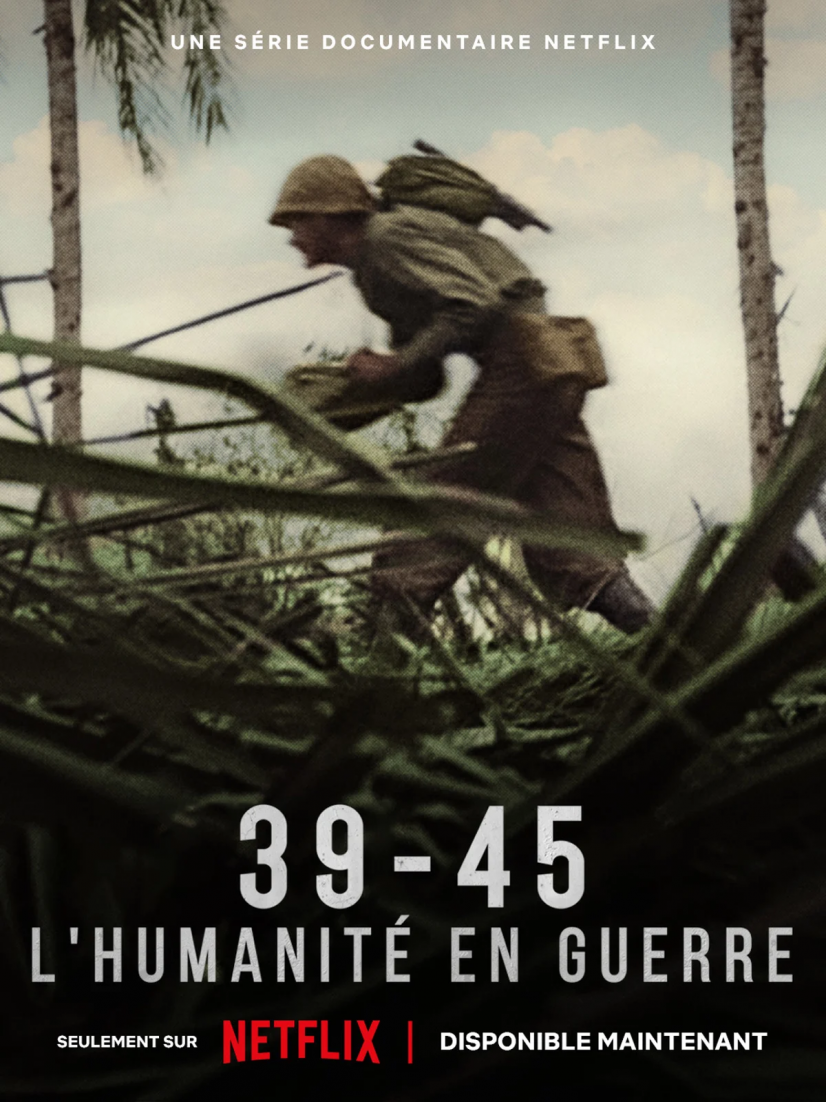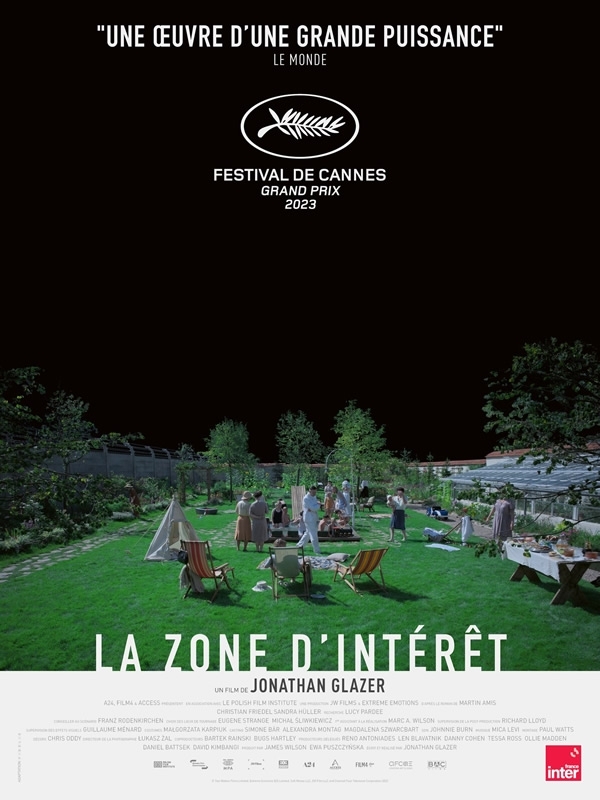Musique ••• Baroque ••• Claudio Monteverdi, L'Incoronazione di Poppea, Les Épopées
Lorsque la Russie s’enlise contre un plus petit qu’elle
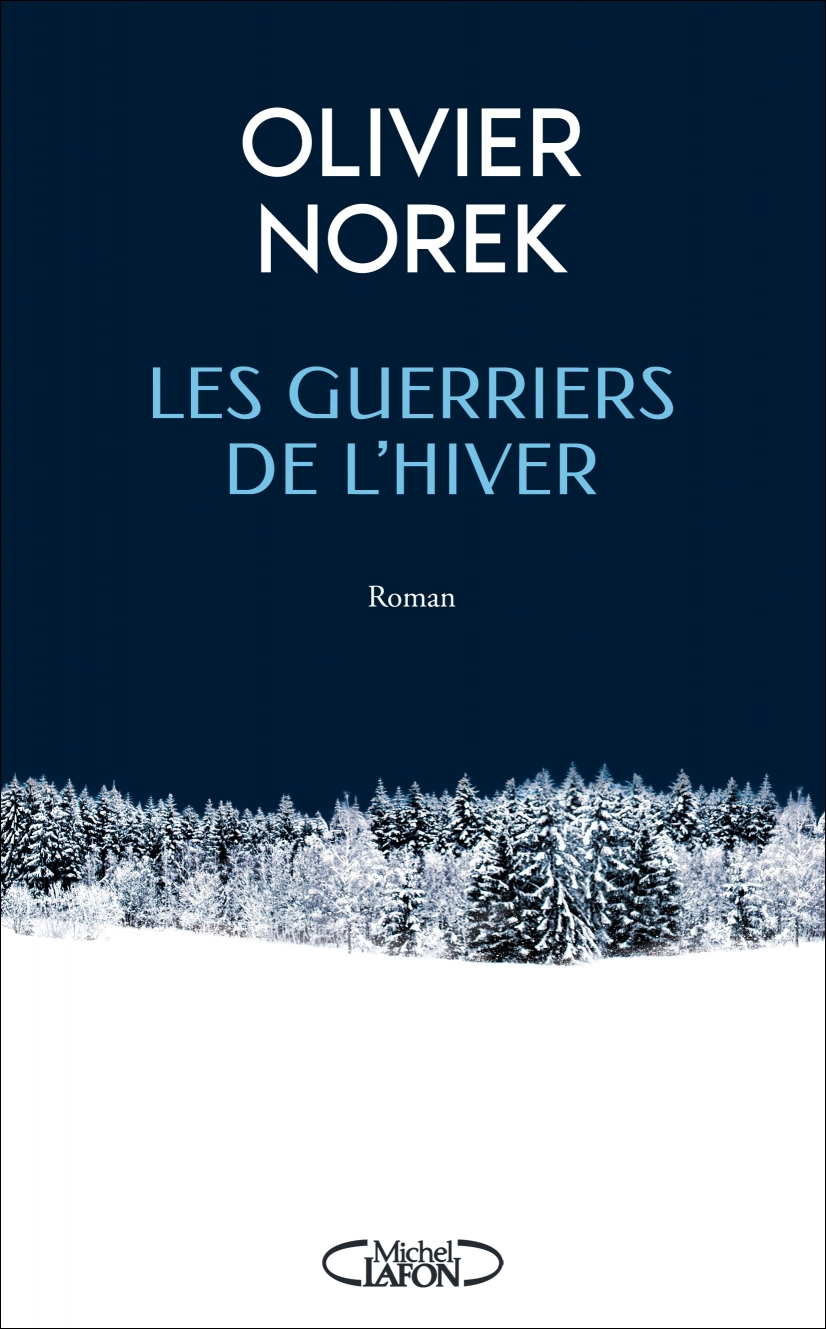
Un dictateur russe, sûr de son génie tactique, se lance dans une opération militaire en s’en prenant à un pays frontalier vingt fois plus petit. Il est certain qu’en quelques jours il mettra au pas son voisin grâce à son armée pléthorique et surarmée, histoire d'annexer un pays et de s'étendre un peu plus. Mais c’est sans compter l’esprit de résistance du pays attaqué.
Vous pensez que l’on parle de la guerre russo-ukrainienne toujours en cours depuis février 2022 ?
Et bien, raté.
Il s’agit de la Guerre d’Hiver déclenchée en novembre 1939 menée par une Russie aussi stupide qu’hautaine contre son voisin finlandais. Ca vous rappelle quelque chose, non ? Contre toute attente, une mobilisation générale a lieu, envoyant des citoyens sur un large front glacé par un hiver particulièrement rigoureux. Mal préparés, sous-estimant leur adversaire et affaiblie par les purges dans l’armée quelques années plus tôt, la Russie - appelée URSS - se casse les dents. Et, par dessus le marché, la Finlande peut compter sur le sniper le plus doué de l’histoire et qui personnifie comme personne l’esprit de résistance du Petit Poucet finnois contre l’ogre russe.
Dans Les Guerriers de l’hiver (éd. Michel Lafon), Olivier Norek choisit de s’attacher à un groupe d’amis de la petite ville de Rautjärvi, non loin de la frontière russe. Parmi ces jeunes appelés finnois, l’attention se porte sur Simo Häyhä, bientôt surnommé "La Mort Blanche" par des soldats russes surpris et terrifiés par les talents de sniper du jeune homme.
Une Russie aussi aveuglée par l’Ukraine qu’elle ne l’a été avec la Finlande il y a 75 ans
Olivier Norek, habitué aux thrillers robustes (Code 93, Territoires, Surtensions, Surface) surprend avec ce roman historique sur un épisode oublié des années 40.
Il est vrai que ce que l’on a appelé la Guerre d’Hiver a été oublié du fait de l’événement monstrueux qu’était La Seconde Guerre Mondiale et qui n’en était qu’à ses débuts. Et pourtant, en Finlande, ce conflit contre la Russie, qui a duré de novembre 1939 à mars 1940 fait figure de moment majeure pour cette nation. Une vraie guerre patriotique aux yeux des Finlandais et voulue par Staline qui voyait dans l’invasion de la Pologne par Hitler l’occasion de s’étendre. Le dirigeant nazi saura se souvenir des difficultés de l’URSS à mettre au pas une nation de quelques millions d’habitants. À peine enclenchée, grâce à un faux attentat (classique !), le dictateur russe est persuadé que l’Armée Rouge ira jusqu’à Helsinki sans problème. C'est l'humiliation pour lui !
Finalement, les enjeux de cette guerre sont moins importants que la vie au plus près du front. L’auteur français consacre des pages hallucinées sur les tueries comme sur l’apprentissage de l’art de la guerre par d’anciens ouvriers ou paysans contre un ennemi surpris par la résistance finnoise comme par l’hiver. Olivier Norek fait aussi et surtout de cette page d’Histoire une illustration de notre actualité, avec une Russie aussi aveuglée par l’Ukraine qu’elle ne l’a été avec la Finlande il y a 75 ans.
Olivier Norek, Les Guerriers de l’hiver, éd. Michel Lafon, 2024, 448 p.
http://michel-lafon.fr/livre/3056-Les_guerriers_de_l_Hiver.html
https://www.facebook.com/oliviernorek
https://www.instagram.com/norekolivier
Voir aussi : "Les quatre fantastiques"
"Sanglantes eighties"
Tenez-vous informés de nos derniers blablas
en vous abonnant gratuitement à notre newsletter.
Likez, partagez et instagramez les blablas de Bla Bla Blog !