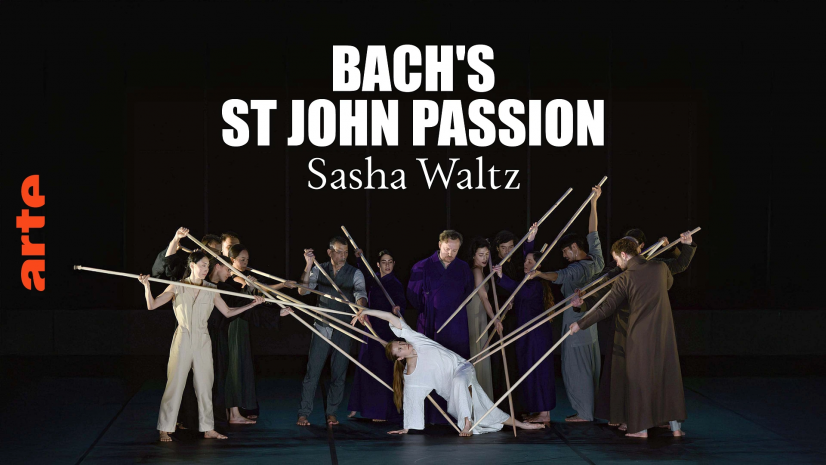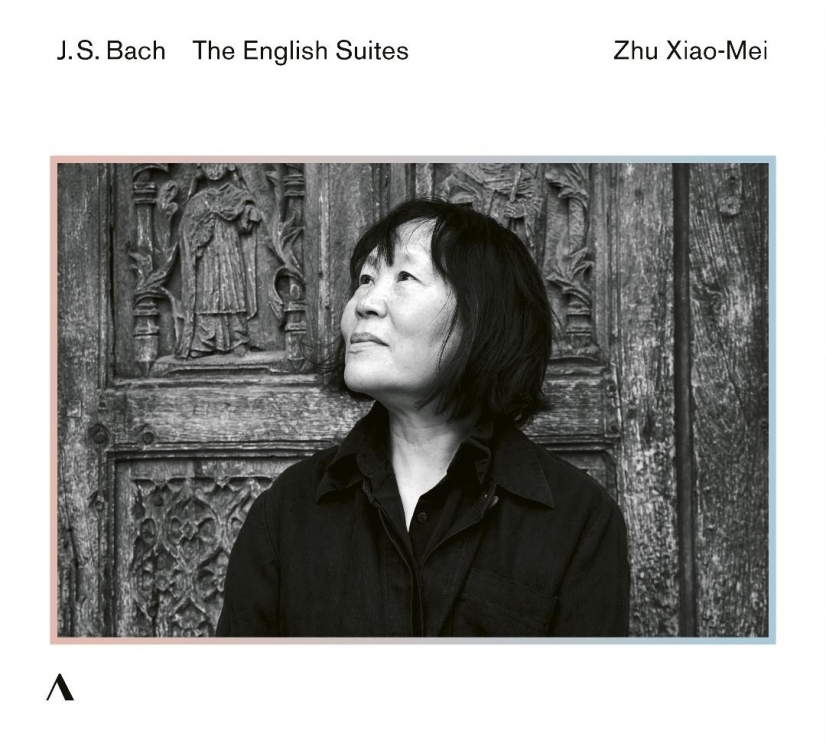Musique & télévision ••• Classique ••• Yuja Wang interprète "Rhapsody in Blue"
Je rêvais d’un autre monde

Cet album propose une plongée dans un univers musical singulier ! Quand je dis "univers", je parle aussi de cosmos, en référence à Primordial Cosmos, la première œuvre qui ouvre l’album Saga Trilogy (b.records) consacré au compositeur contemporain américain Joseph Swensen. Il est en plus aux manettes de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine.
L’ambition de Joseph Swensen sonne immédiatement aux oreilles dans Primordial Cosmos, en deux mouvements, Lento Mesto et Molto agitato. Le compositeur américain, à la baguette pour cet enregistrement, a écrit une musique d’un autre monde, partant d’un magma originel, chaotique, faisant grincer et pleurer les cordes. Joseph Swensen fait de Primordial Cosmos la première partie d’une saga qui le dépasse même, comme il l’avoue dans le livret de présentation.
Dans le mouvement Lento Mesto, l’auditeur ou l’auditrice aura l’impression de voir surgir des particulaires cosmiques primaires au cœur du néant, à la fois inquiétant et fondamental, jusqu’à la formation d’un début d’ordre. Les cordes se structurent peu à peu en nappes. Du chaos naît quelque chose, tout aussi primaire. C’est l’objet du second mouvement Molto Agitato et Andante Sostenuto, plus mystérieux, plus métaphysique aussi. À ce sujet, le compositeur américain avoue l’influence d’Olivier Messiaen, en particulier son Quatuor pour la fin du temps. La facture de Primordial Cosmos devient plus harmonique, pour ne pas dire néoromantique. On ferme les yeux et on se laisse porter par ce souffle délicat, porteur de vie.
La nature a horreur du vide
L’enregistrement se poursuit avec le bien nommé Saga, une pièce pour violoncelle, orchestre et accordéon. Violoncelle avec Jonathan Swensen, fils du compositeur et chef d’orchestre dont la naissance a inspiré l’écriture de cette œuvre. Citons aussi la présence de Bruno Maurice à l’accordéon. Il est rare de voir cet instrument mis à l’honneur dans le répertoire classique et contemporain. Jonathan Swensen domine avec aplomb la partie Méditation, toute en intériorité et en gravité. La musique des sphères devient un mouvement finalement très humain, dans ce bourdonnement cosmique dont les spécialistes de l’espace parlent, non sans émotion. Joseph Swensen nous apprend que ce son primaire, bien réel et dû aux interactions entre trous noirs, a une hauteur spécifique, un si bémol "très, très grave".
La nature a horreur du vide, dit-on. Or, cet espace, ici, est enrichi de constructions sonores tout à fait envoûtantes (Méditation) et passionnantes, à l’instar du Scherzo en forme de Passacaille. Il s’agit là du mouvement sans doute le plus audacieux de Saga, mêlant chaos, rythmiques primaires et percussions joueuses pour parler de la vie s’ébrouant maladroitement. Qui dit Passacaille dit Bach. Or, c’est Bach que l’on trouve derrière l’Aria "After Bach". Le compositeur propose un troisième mouvement réconciliant répertoire classique et création contemporaine. Cela donne une partie somptueuse de langueur, de mélancolie et de méditation, avec ces infimes variations, jusqu’à une dernière section dominée par l’accordéon singulier de Bruno Maurice, au service d’un bouillonnement vital.
La pièce Song Of Infinity, pour clarinette, chœur et orchestre, vient clore ce programme de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine. Joseph Swensen l’a sous-titré "My name is Infinity. As yours will one day be!", que l’on pourrait traduire par : "Mon nom est Infinité. Le vôtre le sera un jour". Le premier mouvement Andante est dominé par un solo de clarinette méditatif, bientôt rejoint par l’orchestre. L’auditeur ou l’auditrice se laissera prendre par la main dans une partie symphonique et même néoromantique, jusqu’à l’arrivée en fanfare de chœurs, dans un beau tohu-bohu. Une arrivée qui marque le début du dernier mouvement Choral, placé sous le signe et l’influence d’Olivier Messiaen. Songs Of Infinity est écrit et interprété comme une œuvre lumineuse et même métaphysique. La clarinette de Stéphane Batut dialogue avec l’orchestre et le chœur, dans un long chant méditatif, comme une prière vers l’au-delà. Et c’est lorsque les voix résonnent que la présence de Messiaen devient la plus évidente. Un vrai voyage cosmique... Pardon, une vraie saga cosmique !
Joseph Swensen, Saga Trilogy, Orchestre National Bordeaux Aquitaine dirigé par Joseph Swensen, b•records, 2025
https://www.b-records.fr/disques/saga-trilogy
https://www.josephswensen.com
https://www.opera-bordeaux.com
Voir aussi : "Pom, pom, pom, pom"
"Parveen Savart : ‘Une modestie bouleversante’"
"Très grand Bacri"
Tenez-vous informés de nos derniers blablas
en vous abonnant gratuitement à notre newsletter.
Likez, partagez et instagramez les blablas de Bla Bla Blog !