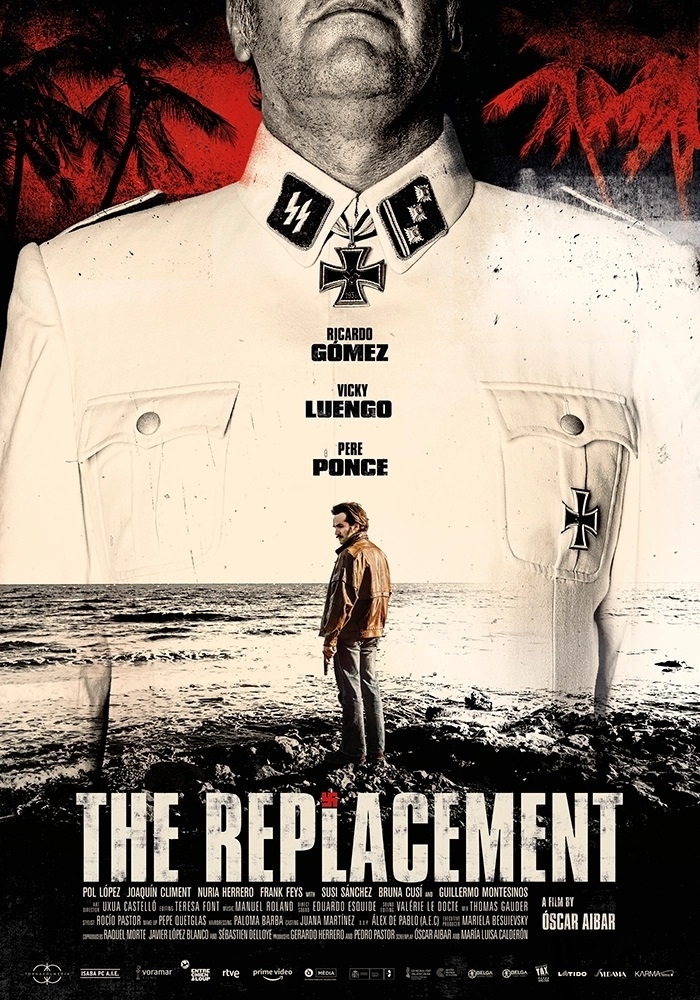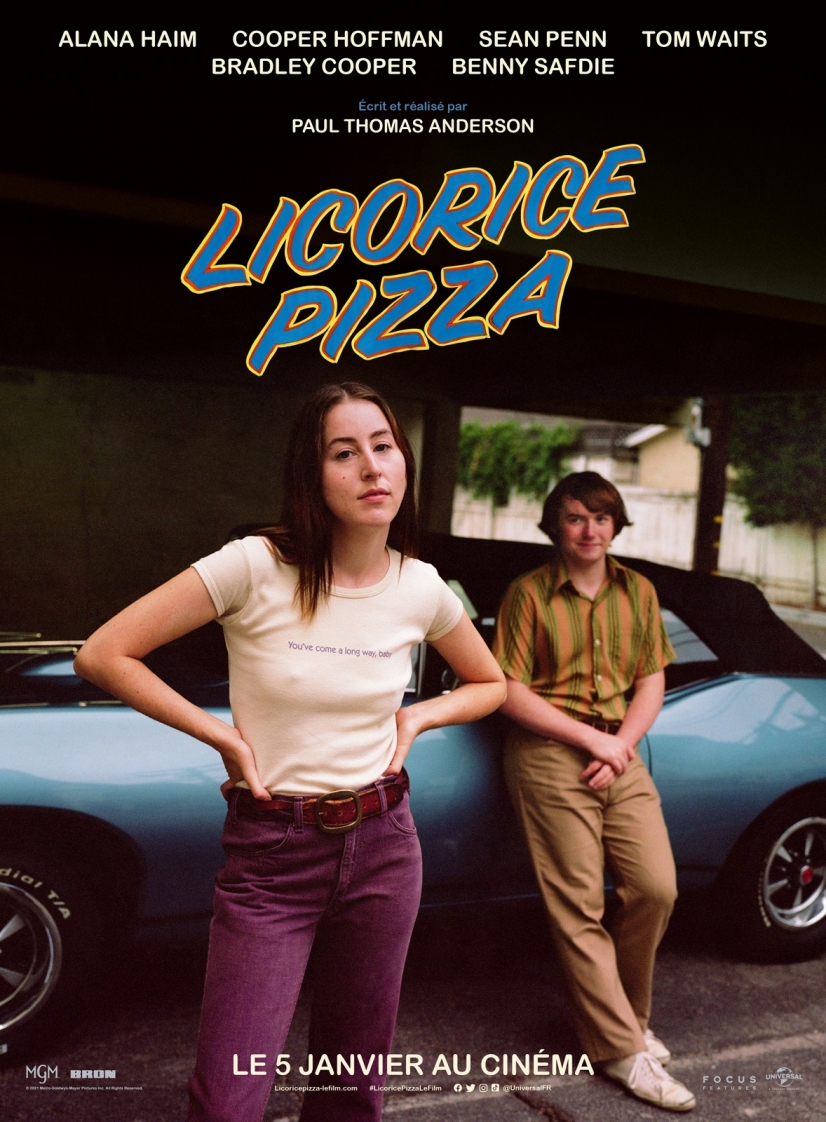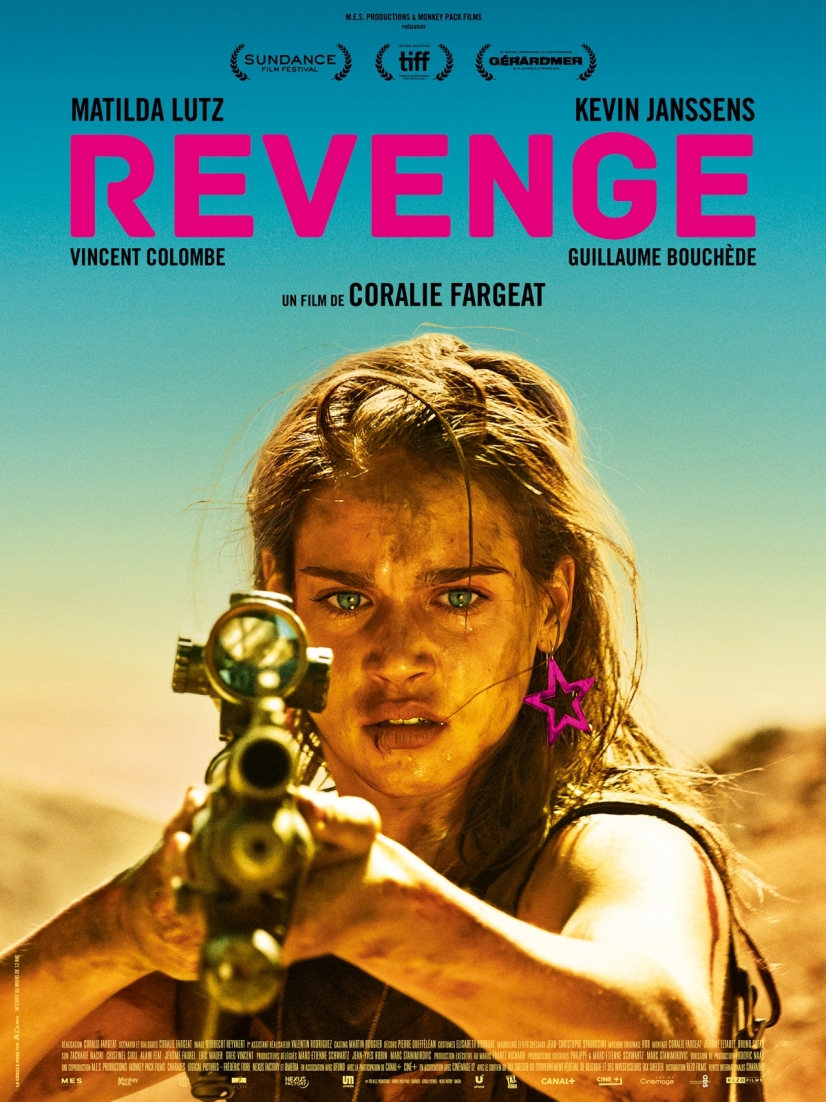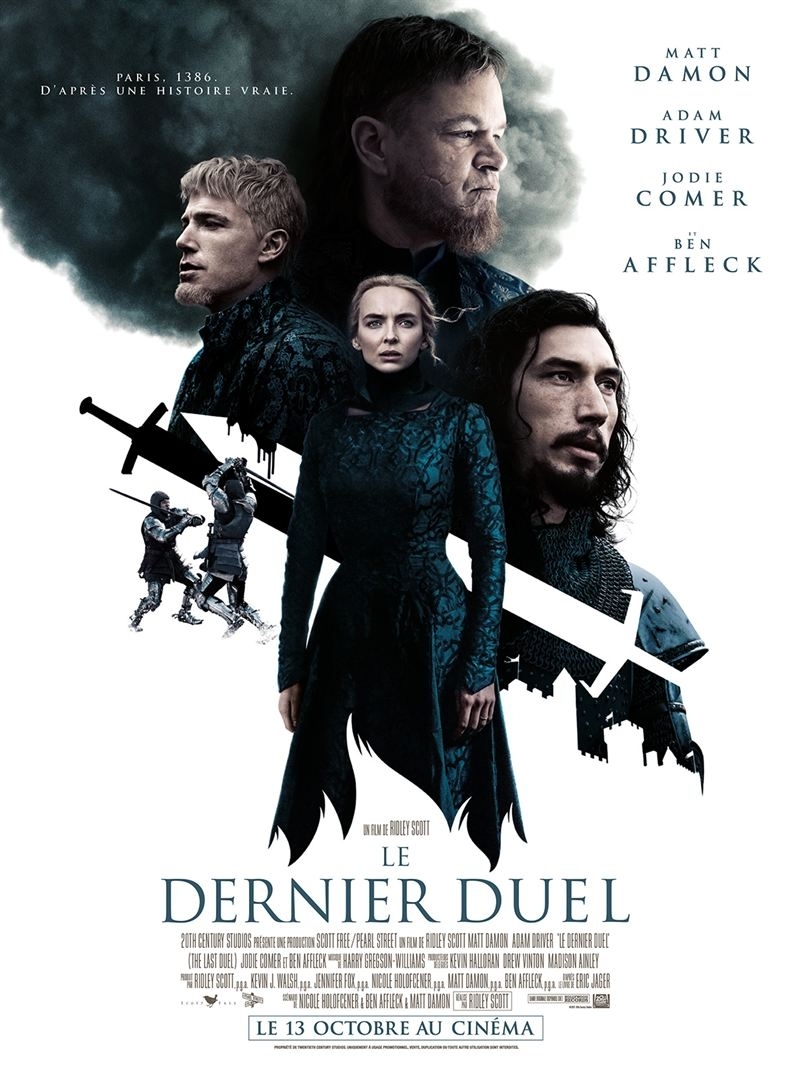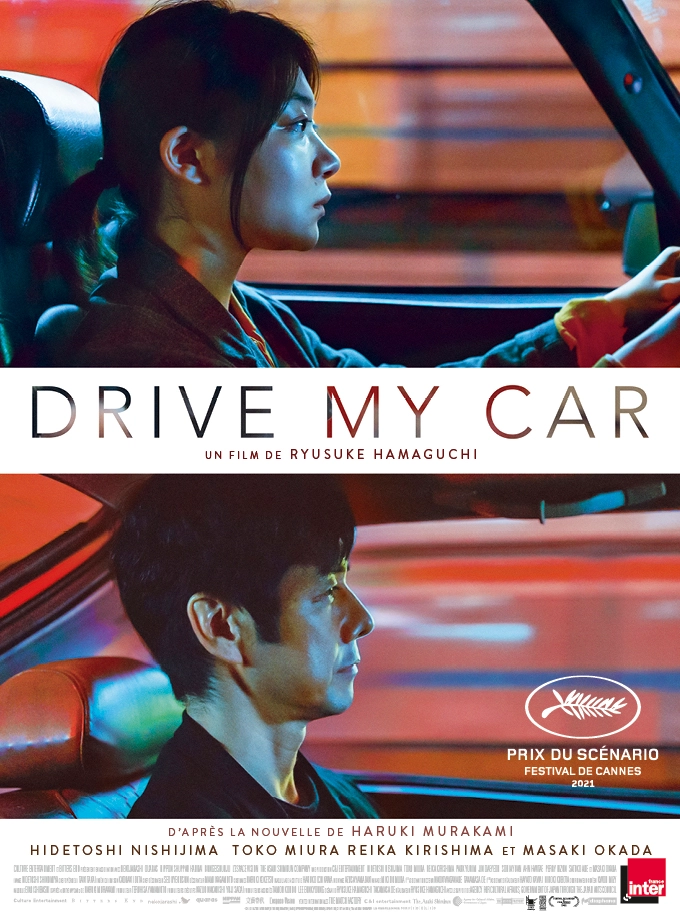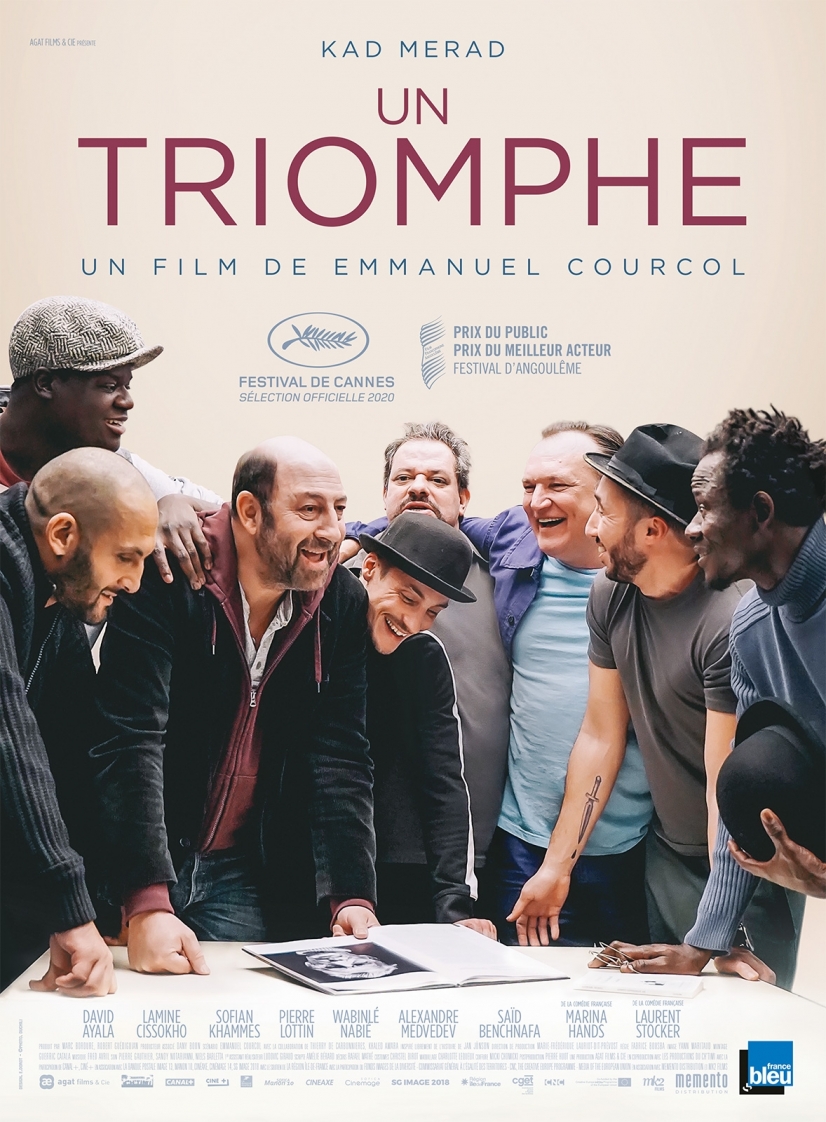ITW & musique ••• Interview de Laureen Stoulig-Thinnes (Venerem)
Être ou ne pas être

Une ombre plane sur All is true, ce film historique de Kenneth Branagh consacré à William Shakespeare : celle d’Hamnet. Hamnet Shakespeare. Les similitudes avec Hamlet sont plus que frappantes : elles éclairent le plus célèbre drame du poète anglais si l’on pense à son jeune fils, mort de la peste en 1596 à l’âge de 11 ans.
Le plus shakespeariens des cinéastes actuels fait débuter son biopic en 1613. Shakespeare retourne dans sa ville de Stratford-upon-Avon après l’incendie de son théâtre du Globe Theatre où se jouait son drame Henri VIII. L’auteur anglais décide d’arrêter l’écriture de pièces. Il rejoint sa femme Anne et ses deux filles, Susanna et Judith. Il ne lui reste plus que trois années à vivre. L’ombre de la mort, de son jeune fils mais aussi de la vanité de son génie, pèsent sur lui. Il doit aussi vivre, entouré des siens.
"Tout est vrai", proclame le titre de ce biopic sur les dernières années d’un homme cherchant l’apaisement et la réconciliation au milieu des siens plutôt que la postérité. C’est un homme face à la mort qui se donne à voir, comme Shakespeare l’a écrit lui-même dans une de ses pièces : "Ne crains plus la chaleur du soleil, / Ni les rages du vent furieux. / Tu as fini ta tâche en ce monde, / Et tu es rentré chez toi, ayant touché tes gages. / Garçons et filles chamarrés doivent tous / Devenir poussière, comme les ramoneurs."
Shakespeare parlant avec son fils mort, ce fameux Hamnet
Il existe très peu de peintures et de dessins du "barde d’Avon" et sa biographie, à commencer par sa date de naissance exacte, est parsemée de lacunes. Voir Shakespeare prendre chair est donc tout sauf anodin, et qui mieux que Kenneth Branagh pouvait s’en charger ? On y découvre le génie anglais dans une simplicité déconcertante : au jardin, en famille avec son épouse plus âgée et ses deux filles, en ville devant se battre contre les ragots, en bisbille avec son gendre puritain, négociant avec son avocat son testament ou parlant avec son fils mort, ce fameux Hamnet.
Shakespeare est-il revenu "victorieux au sein de sa famille" après son triomphe comme auteur et poète, comme l’affirment ses amis ? En réalité, c’est le crépuscule d’un immense artiste qui donne à se voir dans un film construit comme une suite de tableaux à la Rembrandt. Le spectateur pourra se délecter des compositions, des scènes éclairées à la bougie mais aussi des références à l’œuvre du "barde immortel" (celle par exemple avec Ian McKellen, alias le comte de Southampton).
C’est une bonne idée que Netflix propose ce film sorti en 2018, avec un Kenneth Branagh jouant mezza-voce, entouré de "ses" femmes et en premier lieu la toujours exceptionnelle Judi Dench.
All is true, drame historique anglais de Kenneth Branagh,
avec Kenneth Branagh, Judi Dench et Ian McKellen, 2018, 101 mn, Netflix
https://www.sonyclassics.com/allistrue
https://www.netflix.com/fr/title/81034560
Voir aussi : "S’il vous plaît, rembobinez"
Tenez-vous informés de nos derniers blablas
en vous abonnant gratuitement à notre newsletter.
Likez, partagez, twittez et instagramez les blablas de Bla Bla Blog !