Cette chronique exclusive sur Nathalie Arthaud, la candidate Lutte Ouvrière (LO) aux Présidentielles, initie le dossier Présidentielles 2017 de Bla Bla Blog. Jusqu’en mai prochain, nous consacrerons une série d’articles sur cette élection majeure.
Nous avons proposé à Nathalie Arthaud de se prêter à un ensemble de questions : livres ou films préférés, dernier spectacle et exposition vus, acteur et musicien préféré, etc. Elle a bien voulu nous répondre et nous parler un peu d’elle à travers ses goûts.
Vous pouvez retrouver son questionnaire complet en bas de cette chronique, avec également la réponse in extenso à la dernière question : "Quelle politique culturelle envisagez vous de mener en cas de victoire aux Présidentielles ?"
Candidate de Lutte Ouvrière, le parti le plus à gauche des partis de gauche, Nathalie Arthaud étonnera peu en mettant parmi ses livres – politiques – préférés Le Manifeste du Parti Communiste de Karl Marx et Friedrich Engels. Mais là où la candidate se distingue c’est a priori son goût pour la littérature américaine, avec La Route de la Liberté d’Howard Fast, son autre livre de chevet. Roman historique d’un écrivain américain engagé et communiste attaqué par la commission McCarthy durant les années 50, La Route de la Liberté traite de l’émancipation afro-américaine au temps de la guerre de sécession. Le thème de discrimination raciale aux Etats-Unis est un thème qui lui tient à cœur. Tracy Chevalier figure également parmi ses auteurs fétiches. Tracy Chevalier s’est spécialisée dans le roman historique, avec notamment son ouvrage le plus connu, La Fille à la Perle, adaptée avec succès au cinéma, avec Scarlett Johannsson dans le rôle titre.
Deux longs-métrages récents ont été cités à la question sur les films vus au cinéma. Il s’agit de Divines, tout d’abord, une histoire d’émancipations de filles habitant un quartier défavorisé. Le second est Sully, un brillant biopic de Clint Eastwood, avec Tom Hanks, retrace l’histoire vraie d’un héros ordinaire, le pilote de ligne Chesley Sullenberger.
Pour trouver l’acteur et l’actrice favoris de la candidate LO, il faut chercher non pas en France ou aux États-Unis, mais du côté de la Finlande, avec Mads Mikkelsen (Pusher, Casino Royale, La Chasse ou Michael Kohlhaas) ou de l’Iran, avec Golshifteh Farahani (À propos d’Elly, Poulet aux prunes ou Si tu meurs, je te tue de Golshifteh Farahani). Côté metteur en scène préféré, Nathalie Arthaud nomme Quentin Tarantino.
Bla Bla Blog a interrogé la candidate sur sa série préférée. On aurait pu penser que la représentante de Lutte Ouvrière aurait parlé de House of Cards, cruel tableau de la politique et de son cynisme. Mais non : c’est Treme, de David Simon et Eric Overmyer, qui est citée, une série engagée et sociale qui se passe à la Nouvelle-Orléans après le passage de l'ouragan Katrina.
Côté musical, Nathalie Arthaud fait preuve d’un bel éclectisme : variétés, musiques du monde et rock. Mais aussi pop et jazz avec Amy Winehouse, citée comme musicienne favorite.
Sur Bla Bla Blog, nous parlons régulièrement d’expositions et de musées. Des questions étaient donc posées sur ce sujet. Parmi les peintres admirés par la candidate LO figurent en bonne place les fauves et Géricault, le peintre du Radeau de la Méduse. La dernière exposition vue par Nathalie Arthaud a été un événement proposé par le Musée du Quai Branly : Chtchoukine - The Color Line, un "hommage aux artistes et penseurs africains-américains qui ont contribué, durant près d’un siècle et demi de luttes, à estomper cette "ligne de couleur" discriminatoire."
Nous avons interrogé Nathalie Arthaud sur les spectacles vus. Elle nous a cité un opéra, bien loin du cliché que l’on pourrait se faire d’une candidate située à gauche de la gauche : Les Contes d’Hoffmann d’Offenbach. Nous supposons à Bla Bla Blog que Nathalie Arthaud fait ici référence à la récente production à l’opéra Bastille, avec Philippe Jordan à la direction et Robert Carsen à la mise en scène.
Le questionnaire interrogeait la candidate sur ses lectures de magazine : "Aucun d’exclusivement culturel" nous a-t-elle répondu. Quant à ses pratiques d’un art, la candidate à la présidentielle a eu cette réponse élégante : "Mis à part l’art oratoire, aucun."
Le questionnaire complet de Bla Bla Blog, avec les réponses de Nathalie Arthaud
Quel est votre livre préféré ?
Politique : Karl Marx et Friedrich Engels, Le Manifeste du parti communiste
Roman : La route de la liberté, Howard Fast
Quel est votre auteur fétiche ?
Tracy Chevalier
Quel film avez‐vous récemment vu au cinéma ?
Divines - Sully
Quel est votre acteur ou actrice favori ?
Mads Mikkelsen - Golshifteh Farahani
Quel metteur en scène admirez‐vous ?
Tarantino
Quelle série suivez‐vous assidûment en ce moment ?
Treme de David Simon et Eric Overmyer
Quel est votre style de musiques favori ?
Variétés, musique du monde, Rock
Quel est votre compositeur, musicien et/ou chanteur favori ?
Amy Winehouse
Quel est votre peintre favori ?
Les fauves/ Gericault
Quelle est la dernière exposition que vous ayez vue ?
Chtchoukine - The Color Line (Musée du Quai Branly)
Quelle est la dernière pièce de théâtre ou spectacle que vous ayez vue?
Opéra : Les contes d’Hoffmann
Quel journal et/ou magazine lisez‐vous régulièrement ?
Aucun d’exclusivement culturel
Pratiquez-vous vous‐même un art ?
Mis à part l’art oratoire, aucun
Quelle politique culturelle envisagez vous de mener en cas de victoire aux Présidentielles ?
La culture, dans notre société, reste le privilège des classes aisées de la population, ce que je déplore.
Une véritable politique culturelle devrait commencer dès l’école. Cela est indispensable pour les enfants issus de milieux populaires dont les parents n’ont pas la possibilité ni les moyens financiers de leur offrir une ouverture sur le monde, et sur la culture en général. Pour cela, il faudrait rompre avec la politique actuelle des gouvernements qui réduisent des postes d’enseignants et supprime les matières considérées comme accessoires.
L’État devrait aussi encourager toutes les initiatives locales et régionales en faveur de la culture, que ce soit en développant les bibliothèques, l’éveil à la culture scientifique, l’accès à des salles de cinéma ou de théâtre à des prix abordables pour une famille ouvrière, la mise à disposition de locaux dans les communes permettant à chacun de s’initier à la création culturelle. Or, sous prétexte e la crise, il se désengage aussi du domaine culturel comme de tous les services publics, laissant les collectivités locales faire ce qu’elles peuvent avec leurs moyens en baisse.
http://www.nathalie-arthaud.info
https://www.lutte-ouvriere.org
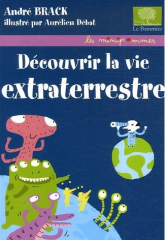

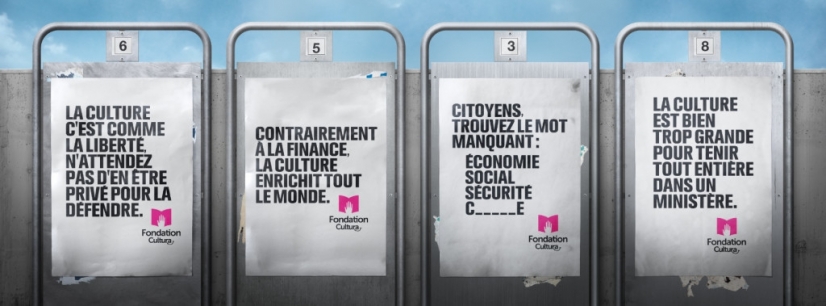

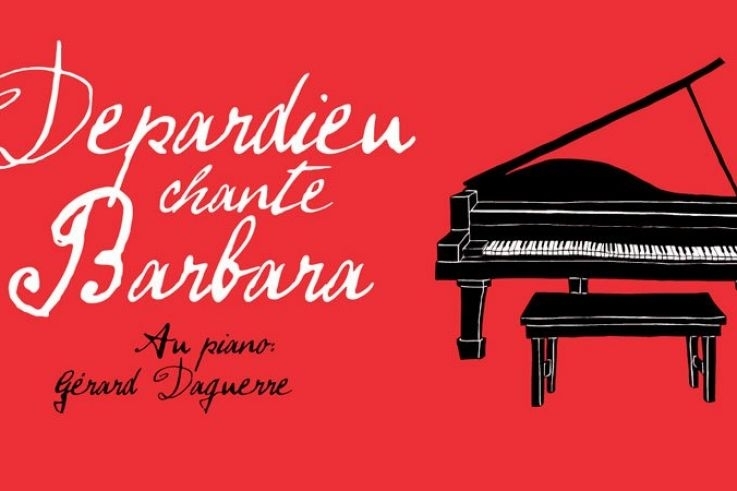
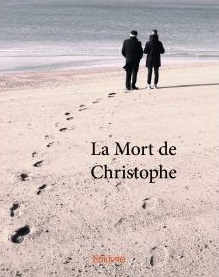 Les premières lignes l’annoncent sèchement et sans échappatoire possible : Christophe va mourir.
Les premières lignes l’annoncent sèchement et sans échappatoire possible : Christophe va mourir. 