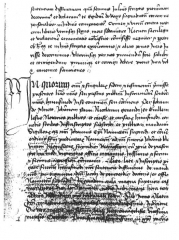Musique & télévision ••• Classique ••• Yuja Wang interprète "Rhapsody in Blue"
Ces inconnus qui nous gouvernent
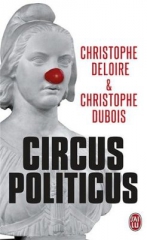 Circus Politicus, essai ambitieux, entend décrire les dérives de nos démocraties actuelles, en ce que la parole des peuples (le "vox populi, vox dei") est très souvent (trop souvent selon les auteurs) considéré par nos dirigeants comme un obstacle à des décisions qui semblent s'imposer. Ces décisions sont liées à de bonnes intentions (une meilleure gouvernance) et à d'autres moins avouables (l'idéologie libérale). Le "circus politicus" est cet univers public et politique fait de faux-semblants, d'apparences, de langues de bois, de discours trompeurs (pour ne pas dire mensongers), de non-dits et surtout de décisions secrètes imposées à tous.
Circus Politicus, essai ambitieux, entend décrire les dérives de nos démocraties actuelles, en ce que la parole des peuples (le "vox populi, vox dei") est très souvent (trop souvent selon les auteurs) considéré par nos dirigeants comme un obstacle à des décisions qui semblent s'imposer. Ces décisions sont liées à de bonnes intentions (une meilleure gouvernance) et à d'autres moins avouables (l'idéologie libérale). Le "circus politicus" est cet univers public et politique fait de faux-semblants, d'apparences, de langues de bois, de discours trompeurs (pour ne pas dire mensongers), de non-dits et surtout de décisions secrètes imposées à tous.
Un des chapitres du livre s'intitule "ministères du monde". Derrière ce terme se cachent des organisations officielles et d'autres officieuses : conseils européens, BCI, agences de notation, organisation mondiale Bilderberg, lobbys internationaux, etc. Pour être honnête, cette première partie gêne aux entournures en ce qu'elle semble faire la part belle à une sorte de complot mondial.
Mais là où l'essai s'avère passionnant est son patient descriptif des institutions européennes. C'est la deuxième partie du livre, la plus volumineuse mais aussi la plus intéressante. Parlement, commission, conseil et autres organismes européens sont passés au crible, pour le meilleur et surtout pour le pire. Les auteurs ne sont pas tendres envers les conseils européens où se décident les grandes décisions à l'échelle du continent : les chefs d'Etat se montrent sous leur plus mauvais jour, d'autant plus que les débats y sont savamment cachés.
On aurait pourtant tort de classer ce livre parmi les critiques des institutions européennes. Deloire et Dubois pointent au contraire du doigt la mesquinerie de l'ensemble de la classe politique française. En privilégiant les élections nationales tout en snobant des institutions aussi importantes que ne l'est, par exemple, le Parlement européen, la plupart des politiques français (mais aussi les énarques et futurs dirigeants) passent à côté de l'Histoire et des décisions les plus capitales pour les citoyens européens. Et, avec toutes ses imperfections, les organismes européens montrent, à la fin de cet essai, une image finalement beaucoup plus reluisante que nombre d'institutions françaises.
Christophe Deloire & Christophe Dubois, Circus Politicus, éd. J'ai Lu, 503 p.